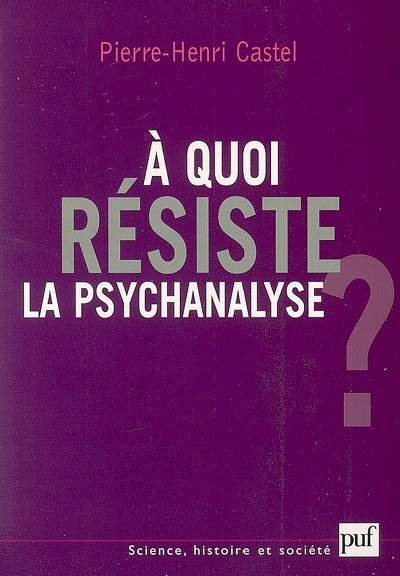A quoi résiste la psychanalyse ? Entretien avec Pierre-Henri Castel
J’ai effectué cet entretien avec Pierre-Henri Castel en 2006 lors de la sortie de son ouvrage A quoi résiste la psychanalyse ?
Une partie devait être publiée dans Les Lettres Françaises. Ce ne fut pas le cas finalement. Je le mets aujourd’hui en ligne car le livre dont il est question est particulièrement intéressant pour le débat sur les enjeux actuels de la psychanalyse.
L’essai de Pierre-Henri Castel est exigeant. Mais il me semble que c’est une invitation à cheminer au travers de ses propres résistances, en tant qu’analyste.
Dans une première partie, il procède à un panorama de la crise « externe », et une revue des critiques les plus saillantes qu’on adresse, parfois violemment, à la psychanalyse. Pierre-Henri Castel y répond, chose rare, en restant sur le plan conceptuel, c’est à dire en restant sur le même terrain que ses adversaires. Point par point, il les réfute. Dans la seconde partie, il analyse les résistances « internes » que la psychanalyse développe à l’égard d’elle-même, et auxquelles il me semble que chaque analyste a affaire. Ainsi dans la partie « La psychanalyse contre elle-même », il dresse un panorama des « dégénérescences théoriques et pratiques » de la psychanalyse qui peut servir à dessiner en creux un portrait ou tout du moins des bornes, des limites, à ce que l’on nomme psychanalyse.
Voici également un lien vers une conférence donnée par Castel en 2010, après la sortie de son livre L’Esprit malade. Cerveaux, folies, individus. Une conférence qui donne le ton l’envergure de son programme. Il y situe ses recherches en épistémologie de la psychiatrie, au milieu des débats entre les neurosciences mettant en avant un paradigme naturaliste (et nécessitant ainsi une naturalisation des concepts psychologiques traditionnels), et les recherches en sciences sociales qui use d’un constructivisme relativiste; aborde ce qu’il entend par esprit (à comprendre avec des lunettes wittgensteiniennes comme une perspective holiste sur l’esprit, dont la nature serait à situer sur le plan social, c’est à dire un esprit construit par des représentations collectives, des règles sociales, des institutions, des formes de vie, etc.) :
L’esprit malade : l’objet même de la psychiatrie
Vous êtes philosophe et psychanalyste, ce qui est finalement assez courant, mais la particularité, c’est que vous travaillez la psychanalyse à partir de la philosophie analytique, et plus particulièrement la philosophie de l’esprit. Cette particularité me semble avoir son importance dans cet ouvrage, c’est-à-dire dans votre lecture de « la crise », mais aussi plus largement dans la lecture que vous faîtes de Freud. Pourriez-vous expliciter un peu ces rapports que vous faîtes entre philosophie analytique et psychanalyse ?
C’est un vieux projet. Parce que mes premiers travaux sur Freud, et même mes premiers travaux sur le contexte historique de la naissance de la psychanalyse, dans La querelle de l’hystérie[1], étaient déjà des travaux qui mettaient l’accent sur les enjeux conceptuels et argumentatifs de la notion d’esprit, d’inconscient, d’émotion, que l’on trouve, pas seulement chez Freud, mais au fond, dans toute une tradition philosophique et d’analyse psychologique, rationaliste, qui était d’ailleurs au 19ème siècle d’inspiration assez souvent spiritualiste, en particulier chez les contemporains de Janet, et qui s’est préservée. En effet, l’idée d’analyse conceptuelle n’est pas le monopole de la philosophie analytique, particulièrement sur les objets psychologiques.
Donc par exemple, lorsque j’ai essayé de montrer que la Traumdeutung[2] était un ouvrage que l’on pouvait comparer aux grands traités philosophiques sur l’esprit, comme par exemple celui de Locke, ou encore les essais terminaux sur la philosophie de la psychologie de Wittgenstein, ce n’est pas exclusivement pour favoriser l’idée de philosophie analytique, mais c’est pour montrer le besoin d’analyse des concepts psychologiques qui permet d’accéder assez rapidement au cœur du rationalisme freudien, qui prend des positions particulières sur ces concepts, sur le rapport du corps, sur la nature de la signification, sur la vie psychique etc.
Ce qui peut être effectivement un trait particulier, c’est que j’utilise souvent des instruments d’analyse assez techniques, dérivés de la philosophie de l’esprit contemporaine, la philosophie of mind, qui est dans mon cas effectivement fortement marquée par Wittgenstein, par des lecteurs contemporains de Wittgenstein, mais aussi des philosophes non-wittgensteiniens comme Donald Davidson. Et aussi par une attention au fait qu’il y a un besoin de maintenir un espace commun de discussion avec les gens qui s’intéressent aux questions de l’esprit, qui ne sont pas simplement les psychologues cognitivistes, mais aussi des gens qui élaborent des réflexions de type moral, sur les émotions, sur la volonté, mais aussi des réflexions de type politique, sur la nature des institutions, sur ce que ce sont les représentations collectives, si elles existent, etc.
Donc en fait l’idée, dans mes travaux, c’est de se donner un instrument philosophique suffisamment subtil, où, en même temps, la boîte à outils est très grande, car la philosophie analytique, c’est un peu comme la métaphysique scolastique, il y a vraiment de quoi puiser énormément d’idées pour en quelque sorte « dé-sédimenter » un certain nombre d’automatismes que l’on peut avoir lorsqu’on lit les textes de Freud, en projetant souvent sans s’en rendre compte, soit des représentations philosophiques anachroniques, soit de simples préjugés de sens commun, dont on ne sait pas que l’on pourrait les faire travailler d’une façon plus complexe.
Evidemment, il est vrai que j’aime bien dans l’idée de philosophie analytique, l’idée d’analyse, et je pense qu’elle est très opératoire, mais elle prime sur l’inscription dans un courant à proprement parler. Car sinon on finirait par succomber à ce piège qui consiste à attribuer à une seule forme de philosophie une sorte de monopole de la rationalité analytique alors que j’ai plutôt tendance à trouver dans la philosophie analytique une boîte à outils et aussi une manière de rendre compte de l’activité rationnelle de Freud dans la psychanalyse.
Ce que j’écris souvent sur le rationalisme freudien est éventuellement critique, car je pense qu’il y a des choses chez Freud qui pourraient être dites de façon beaucoup plus convaincante autrement. Et qu’une des manières que j’ai de comprendre l’histoire de la psychanalyse c’est que, même si cela n’est pas fait explicitement comme cela, il y a des moments dans l’histoire de la psychanalyse où il y a des choses qui relèvent de la clarification conceptuelle et pas simplement d’un progrès empirico-clinique. On peut donc rendre compte de la psychanalyse de manière rationnelle, par endroit, dans un esprit qui n’est pas celui de la philosophie analytique, mais celui d’un rationalisme peut-être plus canguilhemien. C’est alors l’idée de traiter la psychanalyse – c’est un vieux rêve d’un certain nombre d’intellectuels philosophes français à l’égard de la psychanalyse – comme un ensemble de propositions rationnelles, même si elle n’est pas que cela bien entendu, qui progressivement se conquiert historiquement une autonomie normative, et qui est alors capable de dire ce qui relève, ou ce qui ne relève pas, de son champ, et pourquoi, etc.
Pour en revenir à votre ouvrage, « A quoi résiste la psychanalyse ? ». Votre position, contre-critique en quelque sorte, dans la première partie de votre ouvrage, est très intéressante, car on la rencontre très rarement à mon avis. Vous répondez ainsi, point par point, de façon très argumentée, à deux anti-freudiens, Adolf Grünbaum et Mikkel Borch-Jacobsen. Pourquoi, à votre avis, ne trouve-t-on pas plus de réponses aux critiques adressées à la psychanalyse telle que la vôtre chez les psychanalystes ?
Il y a deux choses dans cette question. Il y a d’abord le point de savoir dans quel sens je parle d’une crise de la psychanalyse. Et ensuite, pourquoi avoir choisi Adolf Grünbaum et Mikkel Borch-Jacobsen comme références de ce à quoi, à mon avis, la psychanalyse se doit de répondre, comme elle le peut.
Sur la crise, je voudrais préciser qu’il y a toute une argumentation sociologique extrêmement puissante aujourd’hui qui a largement montré que se présenter comme une discipline en crise, est un moyen de tirer les marrons du feu en se posant dans la figure très particulière des persécutés et des incompris. Tandis que par ailleurs on peut exercer des magistères intellectuels, avoir un poids social dans un système de santé publique, ou représenter des idéaux culturels qui eux sont complètement, en réalité, renforcés par ces attitudes. Moi ce qui m’importe beaucoup, c’est de tenir compte de cette objection-là, comme quoi depuis toujours, et Freud l’a très bien compris, se poser dans la position du persécuté, c’est une attitude dont on voit très bien les bénéfices. Cela attire par exemple un certain nombre d’esprits originaux. En revanche, ce que j’essaie de désigner comme étant une crise réelle, ce n’est pas forcément celle qui est ressentie comme une crise réelle. On peut bien évidemment critiquer cette assertion car je ne suis pas sociologue, et que l’on a assez peu de moyens statistiques empiriques corrects, pour dire si ce que je prétends est suffisamment objectivé. Mais il me semble en tout cas – et c’est assez facilement constatable – qu’il y a disparition de la psychanalyse, au sein de pans entiers du savoir contemporain dans les sciences humaines. Il y a une dilution dans la sphère psychothérapeutique de ce qui était autrefois le monopole de la psychanalyse. Et puis il y a une évidente difficulté qui fait que, même dans les pays comme la France, le recrutement est en crise, aussi bien celui des patients que celui des analystes. Il n’y a donc pas simplement un langage de la crise, mais bien quelque chose de réel.
Alors maintenant pourquoi avoir choisi Adolf Grünbaum et Mikkel Borch-Jacobsen ? Les raisons sont liées au fait que ce ne sont pas simplement des gens qui ont proposé des critiques minutieuses de la psychanalyse, ce sont des gens qui ont proposé des critiques constructives, c’est à dire des critiques où ils ne se contentent pas de pointer les faiblesses d’un dispositif, mais ils s’interrogent sur la façon dont fonctionne ce dispositif, et éventuellement comme il pourrait fonctionner autrement. Donc ils prennent beaucoup plus de risques que ceux que je traite avec un certain mépris il est vrai, ou une certaine ironie, et qui se contentent de recycler des choses qui sont bien connues des professionnels de l’histoire de la psychanalyse, à savoir les incompatibilités manifestes entre différents textes de Freud, les exagérations, les choses que l’on a tenté de cacher dans l’histoire du mouvement analytique et qui ne peuvent que sortir des archives à un moment ou à un autre. Chez ces deux personnes, il y a un pas au-delà.
Chez Grünbaum, il y a entre autres, des conceptions puissantes, bien que je n’en parle pas dans ce livre, sur ce qu’est le placebo, des réflexions vraiment intéressantes sur les problèmes fondamentaux de ce que serait une explication causale en psychopathologie. Je suis sensible au fait qu’il s’est occupé de Freud également pour des raisons culturelles, car il est viennois. Il m’a dit une fois en plaisantant, au fond pour un viennois, il y a deux lectures dans la vie : Einstein et Freud. Aussi quand il eut fini avec Einstein, il est passé à Freud ! Bon alors évidemment il avait déjà plus de 70 ans… Il avait eu à faire avec Einstein ! Mais il faut savoir que Grünbaum est un des plus grands philosophes de la physique de ce siècle, et pas simplement un critique de Freud.
J’ai pris Borch-Jacobsen parce que je trouve ces analyses extrêmement systématiques, et très bien ajustées à des problèmes historiques réels. Le travail qu’il a effectué par exemple avec Sonu Shamdasani, sur l’histoire de la psychanalyse[3], est extrêmement instructif et intéressant. C’est évidemment beaucoup plus intéressant que le livre noir de la psychanalyse[4] à mon sens ou que nombre de textes du même acabit. Et puis, comme il y a également un effort philosophique, ce sont des travaux qui sont dans mes cordes. Je peux éventuellement mettre en cause les concepts qui sont utilisés pour lire et pour critiquer Freud, mais de manière négative, c’est-à-dire que mon travail est un travail de philosophe de la psychanalyse, que je fais en psychanalyste, mais ce n’est pas un travail « de » psychanalyse à proprement parler. Je n’essaie pas de psychanalyser Grünbaum, ou Borch-Jacobsen. C’est essentiel pour moi de dire et de répéter, que ce n’est pas parce que je trouve critiquable les critiques, que pour autant on est quitte, et qu’on a pas de manière positive, à défendre certaines choses. Il y a par exemple un auteur, Vincent Descombes, qui n’est pas connu du milieu des critiques de la psychanalyse, et qui, à mon avis, a fait des observations, notamment sur Lacan, extrêmement profondes et beaucoup plus difficiles à réfuter que celles même de Grünbaum ! Je regrette que l’on ne puisse pas auprès d’un large public intéressé par la psychanalyse, s’interroger sur des positions que je trouve très subtiles, très différenciées, celles de Descombes par exemple.
En effet, en vous lisant, on a parfois l’impression que vous accordez presque plus de crédit aux positions de ces auteurs qu’à bon nombre de psychanalystes, peut-être parce qu’ils vous permettent de développer vos idées et alimenter vos réflexions critiques de l’intérieur de la psychanalyse ?
Oui. Je crois quand même qu’une analyse, c’est censée amener chacun à mesurer le peu que l’on peut savoir et éventuellement la marge considérable d’erreurs, et en fait la responsabilité que l’on prend en défendant certaines positions, dans l’incertitude. Et je ne vois pas très bien ce que l’on aurait à craindre. Je crois qu’effectivement, quand il s’agit d’affrontement de grands discours idéologiques, pour ou contre une certaine manière de se représenter l’homme, je veux bien… Mais je crois que cela va plus loin.
Lorsque je m’en prends à l’argument de la suggestion par exemple, auquel je consacre un développement assez long. Je pense que cela a des conséquences de dire que le mot de suggestion est utilisé dans des discussions psychologiques, où on lui donne une force que je ne crois pas qu’il puisse avoir, et pour des raisons argumentatives et logiques que j’explique en détails. Je pense que c’est assez original parce que beaucoup de psychanalystes pensent que la suggestion est un problème psychologique, un processus psychique particulier. J’ai une position complètement différente sur ce point. Et finalement je ne peux soutenir cette idée, que parce que Borch-Jacobsen, et Grünbaum, mais de manière moins informée, montrent ce que seraient les conséquences logiques de l’usage de ce concept de suggestion. Et ce n’est pas un débat stérile réduit à des oppositions. J’imagine déjà quelles pourraient être les objections que Borch-Jacobsen pourrait en retour faire à ma lecture de son travail sur la suggestion. Je ne crois pas qu’il y ait franchement grand-chose à y perdre ! Quand au fond il s’agit de concepts… Et il me semble en particulier que Borch-Jacobsen, récemment, a finalement attiré l’attention sur le fait qu’il y a une immodestie liée à la transformation de la psychanalyse en psychologie explicative ou en anthropologie générale, qui fait qu’il y aurait un bon usage de ces critiques. Je suis assez d’accord là-dessus.
Il me semble que vous faîtes une peinture au vitriol de l’enseignement de la psychanalyse à l’université. Avez-vous un horizon ou un idéal de ce que pourrait être son enseignement à l’université ?
Ce qui fait que ma peinture est au vitriol, c’est que je doute que l’on puisse faire beaucoup mieux !
Au sens où de toute façon les pauvres collègues universitaires psychanalystes sont confrontés à un problème qui les déborde absolument qui est ce qu’on appelle à l’emporte-pièce « la demande psy ». Les gens veulent bouffer du psychologique ! Il y a des demandes qui motivent des carrières d’étudiants, qui sont des produits très inquiétants d’un désarroi social qui vient s’investir dans des demandes d’explication, des rêves de carrières, des identifications à des personnages soit très bienveillants et maternels, soit très savants, des thérapeutes, etc. Que peut-on faire devant cela ?
Alors évidemment c’est une peinture au vitriol… Je pense qu’il y a des problèmes très graves qui sont liés à la fausseté de la position, c’est à dire que l’université a une fonction de légitimation et de consécration sur des discours, et que ces discours, cela leur fait du mal de se retrouver transformés en contenus de manuel, de cours, etc … Et que le rapport qu’impose l’université entre celui qui sait et celui qui apprend est un rapport beaucoup plus fort que tous les petits déplacements subjectifs qu’une analyse permet à quelqu’un. Il ne faut pas s’imaginer qu’une institution aussi vieille que l’Université, et qui fonctionne aussi bien, ne va pas finir par avoir le dessus sur toute tentative de faire exister un discours psychanalytique comme disait Lacan. D’un autre côté, ce que je dis dans ce livre, c’est une peinture au vitriol, mais elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle que les universitaires psychanalystes peuvent faire eux-mêmes, des impasses dans lesquelles ils sont eux-mêmes. Et certains, du coup peuvent tout de même s’en tirer pas mal, et produire des œuvres de valeur à l’intérieur du dispositif, même s’ils le doivent plus à eux-mêmes qu’à l’institution. Ce qui n’est pas le cas de quelqu’un qui ferait une carrière de biologiste par exemple, et même de philosophe !
Dans cette même ligne, vous écrivez : « L’art de la psychanalyse serait de transformer un Freud récitable en un Freud questionnant»[5]. Vous dénoncez ainsi la transformation d’un discours psychanalytique en un discours de généralités psychologiques. Comment les psychanalystes peuvent-ils résister à cet attrait de la généralité ?
Si on parle « des » psychanalystes, c’est déjà cuit … Puisque l’on a fabriqué une catégorie qui va nécessairement produire des schémas de reconnaissance à l’intérieur du groupe, des discours normés, etc … Ce qu’on peut espérer c’est que ce soit des règles générales ou des généralités qui fassent le moins de mal possible. Parce qu’il faut déjà exister socialement, il faut permettre aux gens de se servir du mot de psychanalyste, en parlant de quelque chose, sans qu’en même temps, le psychanalyste auquel vous allez vous adresser se retrouve tellement enfermé a priori dans ces conceptions-là qu’il ne puisse plus être Vincent Le Corre ou Pierre-Henri Castel ; donc permettre à quelqu’un de pouvoir encore s’adresser, en particulier, à la personne qui vient le consulter.
C’est un problème de juste position entre ce qui est général et ce qui est particulier dans l’usage des mots et la respiration que cela permet pour que l’on puisse à la fois se parler et en même temps se faire place chacun les uns aux autres dans le dispositif.
En même temps, « un Freud questionnant » c’est un vœu pieux. J’en ai bien conscience ! Mais c’est déjà ça ! Je crois que le problème au sujet de cette transformation, c’est qu’elle ne peut pas venir que de l’intérieur de la psychanalyse. C’est la valeur que j’accorde à l’usage que je fais de la philosophie, par exemple. Comme tout ce qui est prise de conscience, cela se réfère à des valeurs de rationalité, de conscience, de responsabilité, sur lesquelles il n’y a pas de monopole du discours psychanalytique. Cela peut être aussi quelque chose qui a des moyens politiques, cela peut être aussi quelque chose qui a des moyens spirituels, bien que cela n’ait pas ma faveur…
Même si la psychanalyse n’est pas du tout, selon le mot horrible « une science juive », je ne suis pas sûr du tout qu’il n’y ait pas dans le judaïsme contemporain quelque chose qui soit susceptible justement de « transformer ce Freud récitable en un Freud questionnant ».
Ou comme Fehti Benslama l’a extrêmement bien montré[6], même des religions, comme l’Islam, qui semblent avoir une aversion structurale pour un certain nombre de questions, comme celle de la femme par exemple, peuvent être en mesure de poser de sacrées questions, à l’intérieur même de ce que l’on appelle le monothéisme. Il y a donc plusieurs entrées, et je ne prétends pas en avoir donné qu’une, avec la philosophie. Peut-être aussi une entrée esthétique, je ne suis pas contre ! Je ne sais pas…
Votre position sur l’évaluation est singulière par rapport aux autres voix que l’on peut entendre ces derniers temps. Par exemple, vous ne cherchez pas à disqualifier les résultats des Thérapies Comportementales et Cognitives, et vous leur reconnaissez même un réel intérêt. Pensez-vous qu’un certain éclectisme pratique puisse être utile ?
Alors je réponds par la fin. Je suis viscéralement opposé à tout éclectisme. Je crois que le type d’engagement que suppose une analyse à l’égard de certains patients exclut totalement l’action comportementaliste standardisée qui, dans un certain nombre de cultures médicales, prévaut. Même si elle ne prévaut pas dans les faits ! Car il faut faire très attention à ce que les gens disent faire et à ce qu’ils font réellement ! Ils sont souvent beaucoup plus pénétrants psychologiquement et font beaucoup plus de soutien qu’ils ne le prétendent… Néanmoins on ne peut pas mélanger !
C’est aussi une pratique hospitalière qui m’amène à dire un certain nombre de choses. Je crois que, pour prendre un exemple simple, à partir d’une catégorie employée dans les TCC, les TOC, lorsqu’une femme d’une soixante d’années passe huit heures par jour absorbée dans des rituels absolument épouvantables dont elle ne peut pas se dégager, et que par le biais d’une thérapie cognitive et comportementale on réussit à diminuer de moitié le temps qu’elle passe à ses rituels, je crois qu’il serait irresponsable de dire qu’il ne s’est rien passé, et que l’on a rien gagné.
Je crois aussi que Feud lui-même a dit plusieurs fois, qu’il y a des choses dont il faut avoir la modestie de reconnaître qu’elles sont inaccessibles à une approche psychanalytique. Il y a des choses pour lesquelles ce n’est pas parce que nous sommes incapables en tant qu’analystes d’y porter secours ou remède que pour autant il faut discréditer totalement, et surtout pour des raisons qui sont profondément ignorantes des pratiques, car il y a très peu de psychanalystes qui ont une connaissance précise de la littérature scientifique sur ces questions. Je veux dire même une compréhension parfois des concepts statistiques qui sont souvent beaucoup plus compliqués qu’on ne le croit, et de l’histoire de ces méthodes. Il faut le dire, on n’a pas d’histoire aujourd’hui, rigoureuse et bien faite, de l’évolution de l’histoire de ces méthodes cognitives, même pour une seule pathologie. Donc ce sont des jugements qui me paraissent tout à fait excessifs.
Pour autant, je suis sensible aussi par le fait que beaucoup de psychanalystes aujourd’hui, et moi-même par exemple, reçoivent beaucoup de gens qui sont passés par ces méthodes et qui ne les ont pas supportées pour des raisons qui les amènent finalement à l’analyse. Et ça, c’est vraiment un phénomène nouveau. Car auparavant, les patients des thérapies comportementales ou des TCC étaient bien souvent des patients dont la psychanalyse avait échoué, ou qui avaient vécu ce qui s’était passé durant leur analyse comme insuffisant, même s’ils y reconnaissaient un intérêt. Maintenant, on a des allers-retours, dans les deux sens. Et, de fait, je suis d’accord pour dire que, bien souvent, à mesure que les TCC sont sorties du cadre où elles étaient pratiquées par des experts, dans des services universitaires, avec un suivi, un soin et une attention toute particulière, bref tout un cadre pour des patients gravement malades, elles se sont transformées en techniques thérapeutiques où les gens sont beaucoup moins bien soignés, même s’ils sont traités selon des canons qui, formellement, ont l’air d’être les mêmes. Quant au soin à proprement parlé, qui est une composante essentielle, il semble beaucoup moins bon, et les gens viennent se plaindre de ne simplement jamais avoir été entendus ! Tandis que l’on ne peut pas dire, pour les petits points d’histoire que j’ai vraiment travaillés moi-même, soigneusement, en prenant l’histoire des articles autour des TOC, qu’à l’origine de ces méthodes, les gens aient été à ce point ignorés.
Il est vrai que j’entends beaucoup de gens qui ont commencé par une thérapie cognitive, puis qui s’oriente vers un psychanalyste, car il souhaite autre chose… Il suive une TCC pendant trois, six mois, et se disent, bon, j’ai l’impression d’en avoir fait le tour, j’ai envie d’autre chose…
Oui, absolument, et de même que l’on peut trouver des cognitivistes qui vous disent qu’ils ont accueilli d’anciens patients de psychanalystes, qui en avaient tiré beaucoup de profit, mais qui restaient, par exemple, avec un phobie bien particulière, un élément qu’un simple déconditionnement très rapide a éliminé. Et je ne vois pas pourquoi l’on irait dire à ces gens qu’ils ont été « prostituer » leur analyse, ou qu’ils se sont laissés traiter comme des rats de laboratoire, pour le type de gain qu’ils en ont eu.
Je crois aussi que cela va se généraliser dans la mesure où, si je n’aime pas l’éclectisme, chacun d’entre nous est éclectique en tant qu’individu, dans la mesure où il vit dans une société consumériste et va où souffle le vent…
De toute façon sur le marché très réel des psychothérapies, l’éclectisme est la norme. Il l’est même, et c’est extrêmement inquiétant, lorsqu’on voit des gens se former, même dans des associations psychanalytiques très respectables, il arrive des gens avec des parcours de formation qui laissent pantois, passant par des écoles de psychothérapie… Et les gens de ma génération s’interrogent vraiment sur ce qu’ils viennent faire, qu’est-ce qu’ils viennent demander d’une formation analytique…
On propose effectivement aujourd’hui, au sein de l’université, un enseignement théorique au niveau des psychothérapies qui prône une sorte de tentative d’intégration de ce que proposerait de meilleur chaque psychothérapie, en fonction par exemple de tel ou tel type de pathologie, ou symptôme…
Je suis très sensible à ce type de choses, mais il y a souvent un abîme entre ce que les gens disent et même ce qu’ils croient faire, et ce qu’ils font réellement.
On pourrait construire des situations paradoxales extrêmement significatives… Cela a été fait. Par exemple, en montrant que certaines interventions de Carl Rogers étaient d’une subtilité qui ne déparait pas avec ce qu’un psychanalyste expérimenté aurait fait avec tel de ses patients. Et a contrario, on pourrait aussi bien montrer que certaines interventions prétendument haut de gamme lacanienne, relèvent de pratiques qui seraient pratiquement du conditionnement, de l’endoctrinement théorico-clinique, absolument cynique.
Donc qui dit faire quoi ? C’est vraiment très important ! Et l’usage des théories dans le champ psychothérapeutique est beaucoup plus fait pour se distinguer du concurrent, que pour décrire vraiment la pratique à laquelle on se livre. Et je ne connais pas de remède à ce problème très sensible.
Dans la fin de votre livre, vous abordez la question des rapports entre la théorie psychanalytique et les questions du genre, mais aussi l’usage de la théorie psychanalytique dans la critique actuelle du libéralisme économique. Et vous êtes très critique à ce sujet. Là encore, votre discours est singulier. Pourrait-on dire en somme que vous luttez pour une psychanalyse émancipée de la lutte politique ?
Je ne crois pas que le propre de la psychanalyse, ce soit d’être politique. Je pense par contre qu’elle rend les clivages politiques souvent beaucoup plus clairs et beaucoup plus violents, parfois entre l’analyste et l’analysant, parfois à l’intérieur même de l’analysant.
Ce n’est pas que je revendiquerai une sorte d’apolitisme de la psychanalyse, mais les vrais conflits réels auxquels les gens sont confrontés, on ne peut pas retirer le contexte politique des questions de sexualité, ce n’est pas le seul contexte qu’elle a, mais elle possède bien un contexte politique. Et bien cela jette une lumière un peu vive sur les choses qui sont en conflit à ce niveau-là aussi chez les gens. Maintenant, ce qu’il me paraît vain dans les usages libertaires ou les usages ouvertement réactionnaires du discours psychanalytique, c’est que les patients n’en ont rien à faire !
Ca ne changera pas, parce que les contraintes réelles qui sont exercées sur eux, sont tellement fortes, qu’aller s’imaginer que l’on peut avoir un gain quelconque en étant plutôt libertaire, ou plutôt réactionnaire, cela me semble futile…
On va simplement prostituer la psychanalyse à être, comme j’essaie de le dénoncer, une nouvelle valeur sur le marché de la morale, et on va simplement supprimer un moyen de faire un pas de côté. Ce que je peux dire, c’est que la psychanalyse ne peut pas guider les gens dans une certaine direction, quand bien même elle le voudrait. Je suis assez sceptique là-dessus. Elle peut les éclairer. Mais dans la vie, il n’y a pas simplement à être éclairé, il y a à avancer. Et avancer, on ne peut le faire à la place des gens. Mais la psychanalyse peut juste faire de la lumière sur certaines choses qui sont en jeu…
Mais vous ne pensez pas qu’une certaine lutte, disons alors extra-psychanalytique dans ce cas, peut-être, serait légitime et nécessaire pour maintenir une clinique digne de ce nom, et que le contexte socio-politique serait de moins en moins favorable à un certain type de clinique ?
Certainement ! Mais on n’a pas besoin de la psychanalyse, ni d’être psychanalyste, et même peut-être d’être psychanalysé, pour être conscient que les enjeux de ce qui nous menace sont considérables.
L’attachement à la possibilité d’avoir une vie privée, vraiment privée ! La possibilité de décider minimalement quand même de son destin, professionnel, d’être à l’abri d’un certain nombre de violence économique, social… Il n’y a pas vraiment de manière psychanalytique de répondre à ce type de question. Le fait est que la psychanalyse, en gros, n’existe que dans les sociétés individualistes avec des systèmes de droits libéraux. Elle existe d’ailleurs en général comme une profession libérale, et dans des systèmes sociaux qui ont des moyens pour s’intéresser à la vie psychique et à la santé mentale des masses. Elle n’existe pas ailleurs.
Est-ce que pour autant il faut transformer le discours psychanalytique, soit en une caution de la vérité de ce qu’on dit sur ce système pour ou contre lui, soit en un instrument pour y promouvoir des positions politiques particulières ? Je sais bien que l’on n’empêchera pas les gens de le faire, mais c’est contingent, et non nécessaire.
On ne cesse donc pas de faire de la psychanalyse ou d’être psychanalyste quand on est sceptique à l’égard de cet usage des concepts psychanalytiques. A mon avis, ce n’est donc pas une nécessité d’essence pour la psychanalyse d’être d’un côté ou de l’autre… A mon avis…
A supposé que vous soyez psychanalyste, bien psychanalysé ou pas, cela ne vous dispense pas de vous comporter en citoyen responsable ! Et on peut parfaitement défendre la psychanalyse contre certains assauts administratifs, comme certains responsables politiques l’ont fait, pas du tout à cause de la psychanalyse, mais parce qu’ils considèrent que dans une société où la liberté ne doit pas être un mot vide, la psychanalyse doit avoir sa place. Vis-à-vis de la manière dont ils se représentaient la société, ils pensaient qu’il devait y avoir une place pour la psychanalyse.
Le risque que vous voulez pointer, c’est qu’elle y perde …
Je crois que ce n’est pas un risque, c’est une réalité ! Chaque fois que la psychanalyse se met à la remorque, soit d’idéaux libertaires comme on peut parfois le voir à propos de la notion de genre, soit au contraire de positions où on transforme des contraintes subtiles et sophistiquées portant sur l’ordre symbolique en essayant d’en faire une norme du bon psychisme de l’individu aujourd’hui, la psychanalyse disparaît. Et parfois elle disparaît même à la simple lecture du programme. Le simple énoncé de ce qui est voulu par ces usages de la psychanalyse vous fait assister à l’évaporation instantanée de son contenu psychanalytique.
C’est donc exactement l’inverse de cet usage particulier du discours qui pose le problème et qui met en mouvement chacun lorsqu’il est confronté à la lecture de Freud.
Je voulais vous poser une dernière question sur ce que vous appelez l’appropriation subjective des différents savoirs. Est-ce qu’il serait possible de différencier les savoirs selon qu’ils nécessitent ou pas cette appropriation, elle-même liée au concept de résistance…
C’est une question réellement embarrassante. Car on pourrait tout à fait imaginer que les mathématiques nécessitent également une appropriation subjective. Je serai assez partisan pour penser cela. Les mathématiques, non seulement il faut les apprendre, mais il faut qu’un jour, quelqu’un se place avec vous sur un coin de table et vous montre ce que c’est une démonstration. Ca ne vient pas comme ça… En philosophie, c’est une évidence. Mais même en mathématiques… Je pense que les « vrais savoirs », et il n’y en a pas beaucoup, il y a les mathématiques, le droit, l’histoire, la philosophie… les « vrais savoirs » sont des savoirs qui sont « éternels » parce qu’ils vivent de cette possibilité d’interroger la subjectivité dans ses tréfonds. Le marketing, par exemple, n’est évidemment pas un « vrai savoir ». La psychologie, c’est un conglomérat de choses qui sont parfois de vrais savoirs, parfois des discours vides. Au final, ce n’est pas un vrai savoir. La sociologie, son enracinement dans l’histoire, dans l’engagement militant politique en fait quelque chose qui est susceptible d’avoir au final en quelque sorte une figure subjective du sociologue. Il y en a des grands… Je pense que la psychanalyse est de l’ordre de ces savoirs-là.
Si on avait un enfant à élever, qu’aimerait-on qu’il étudie ? Si on se pose la question comme cela, on pourrait se demander ce qui forme quelqu’un. Qu’est ce qui fait que quelqu’un va être transformé, profondément, par le savoir qu’il apprend. Et bien, il peut faire de la médecine, ça va le transformer. A un certain niveau, c’est la même chose pour le droit ou pour les mathématiques… Je pense que c’est le cas pour la psychanalyse. Mais je suis beaucoup plus sceptique à l’égard d’autres connaissances.
Ce sont des savoirs qui sont éventuellement capables de faire des dégâts aussi. C’est-à-dire des savoirs qui peuvent fonctionner de manière toxique. Chez certains esprits, dans la mesure même où la génialité y est parfois possible. C’est très sensible par exemple dans les mathématiques, ou quand on voit ce que c’est qu’un grand juriste. Et ça, il me semble que c’est un élément anhistorique… C’est un vrai problème que de savoir si les sciences humaines, qui sont des sciences issus du 19ème siècle ont « une organisation psychiquement assimilable » qui permettent cette subjectivation. Peut-être que la psychanalyse a réussi cela, peut-être même l’a-t-elle trop réussi ? C’est moins évident avec d’autres sciences alors que ça ne cesse absolument pas de l’être pour les gens qui pratiquent la physique mathématique, ou des sciences exactes au plus haut niveau, ou du droit, ou encore de la théologie. J’avais oublié la théologie !
Ce qui me paraît toujours extrêmement frappant et ce qui m’inquiète beaucoup, c’est qu’est-ce qu’on peut attendre d’un esprit qui voudrait devenir psychanalyste, d’un jeune esprit. Beaucoup viennent de la psychologie. Je pense que c’est une très bonne formation que de faire de la médecine, des mathématiques, de la philologie, ou un de ces savoirs qui, déjà, vous confrontent avec des contraintes sur la vérité et sur le réel qui sont formatrices. Il faut avoir fait des études, et il faut être cultivé pour être psychanalyste. Mais si on n’a jamais rien fait qui puisse vous apprendre à quel point on peut se tromper… A quel point il faut du temps pour devenir capable de faire des choses extrêmement difficiles, vous n’avez pas les conditions, je dirais, de base, pour faire un bon analyste.
[1] Pierre-Henri Castel, La querelle de l’hystérie, PUF, 1998.
[2] Sigmund Freud, L’interprétation du rêves, in Œuvres complètes, tome IV, PUF. Et le commentaire analytique de Pierre-Henri Castel : Introduction à l’interprétation du rêve, de Freud, PUF, 1998.
[3] Sonu Shamdasani, Mikkel Borch-Jacobsen, Le dossier Freud : Enquête sur l’histoire de la psychanalyse, Empêcheurs de Penser en Rond, 2006.
[4] Sous la direction de Catherine Meyer, Le livre noir de la psychanalyse : Vivre, penser et aller mieux sans Freud, DOCUMENTS, 2005
[5] Pierre-Henri Castel, A quoi résiste la psychanalyse ?, PUF, 2006, p. 96.
[6] Fehti Benslama , La psychanalyse à l’épreuve de l’islam, Flammarion, 2004.
mot(s)-clé(s) : épistémologie, Freud, philosophie, psychanalyse, université
You can leave a response, or trackback from your own site.